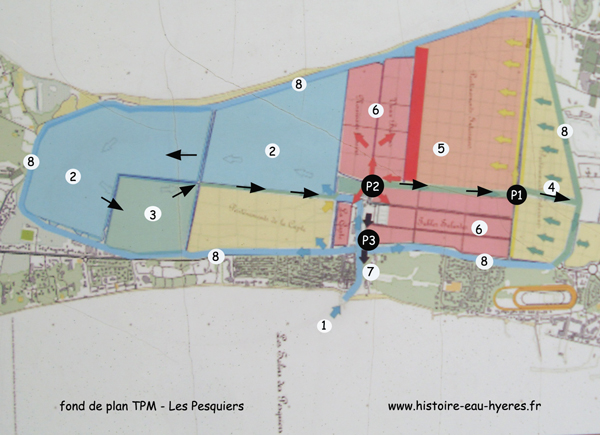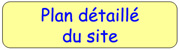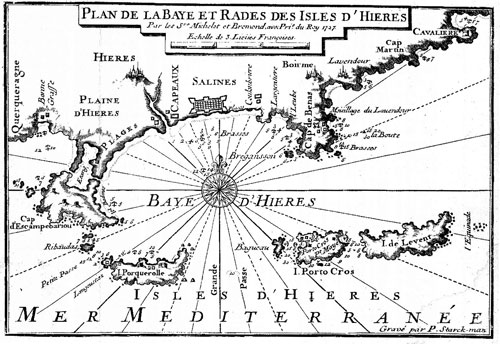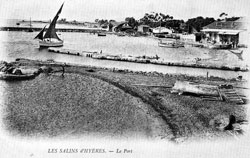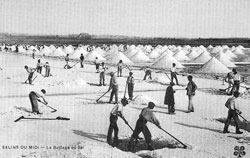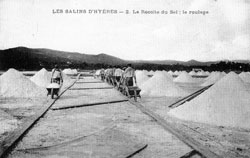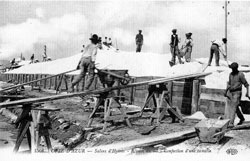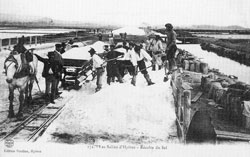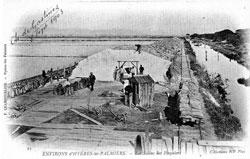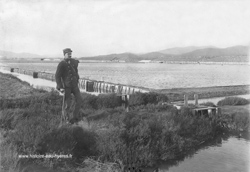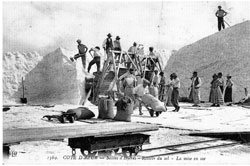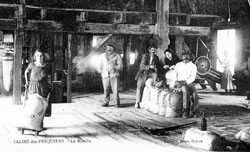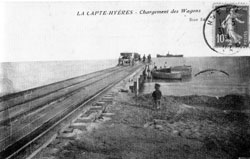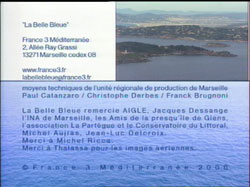|
|
|
|
L'eau
de mer - les marais salants |
|
| |
|
Les
salines d'Eres, Ières, d'Hières et d'Hyères |
|
Introduction
Notre ville d'Hyères (initialement
"Eres") a la
particularité de se situer au bord de la mer méditerranée.
Depuis l'antiquité "l'eau de mer" a donc été
exploité d'une façon empirique, puis artisanale pour
en arriver jusqu'à un stade industriel.
|
| Les
besoins
De tout temps, le sel a été un des éléments
irremplaçables pour la nourriture et la conservation des aliments
de l'homme. C'est surtout "le sodium" principal composant
du sel qui est indispensable aux réactions chimiques du corps
humain. Ceux-ci sont évalués à 5 grammes par jour
alors que nous en consommons ... environ 20 grammes.
Le commerce du sel alimentait, non seulement les caravanes du désert,
mais c'était aussi un des moyens d'échange déjà
connu entre les phéniciens et les étrusques et les premiers
"sauniers" de notre côte. Dans la Rome Antique, le sel
était un produit luxeux, à un point tel qu'il servait
à récompenser les soldats. C'est l'origine étymologique
du mot "salaire".
Les
Méthodes
L'eau de mer contient une quantité variable de sel suivant les
mers. Cela va de 10 grammes par litre dans la mer Baltique à
29 grammes par litre pour la mer Méditerranée dans notre
région.
Il existe deux méthodes pour extraire le sel de l'eau de mer:
-- L'évaporation forcée.
On trouve trace de cette méthode sur les côtes saintongeaises
(Charente-Maritime actuelle) dès l'âge
du fer (700 avant JC). Le principe consiste simplement
à remplir d'eau de mer des récipients de terre cuite que
l'on dépose près du feu. A mesure que l'eau s'évapore,
les récipients sont complétés d'eau de mer jusqu'à
ce que ceux-ci soient remplis de sel. Les récipients sont alors
cassés et les blocs obtenus qui sont très compact peuvent
être facilement transportés.
Sur notre commune nous n'avons pas trouvé trace de cette technique
qui semble plutôt correspondre à la satisfaction de besoins
familiaux.
-- L'évaporation lente.
Cette technique est la plus connue. Elle consiste à faire évaporer
naturellement l'eau de mer dans une région ayant à la
fois :
- un fort ensoleillement,
- un bonne ventilation des plans d'eau afin de favoriser un bon rendement,
- des surfaces planes importantes permettant l'aménagement de
marais salants.
- Dans notre commune, toute la zone comprise entre
Les Salines (à l'Est de l'embouchure du Gapeau) et la presqu'île
de Giens a présenté ces caractéristiques. |

Grain de sel

Marais "sauvage" et la
formation de sel - (zoom)
|
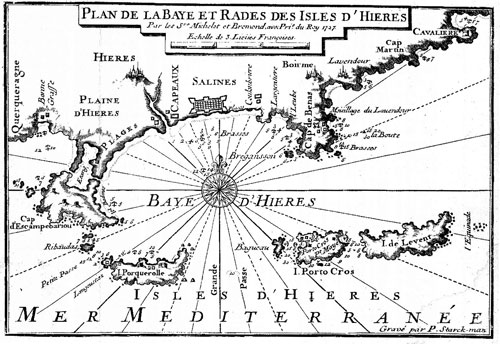
Plan de la "Baye d'Hières"
de 1727 avec la position des SALINES. A cette date on peut observer
un passage
dans le cordon ouest de l'étang du Pesquier qui pouvait éventuellement
éviter aux bateaux de tailles modestes de contourner la Presqu'île
de Giens.
Cette brèche dans le cordon ouest s'est probablement faite
suite à de fortes intempéries.
|
 Gravure de la récolte du
sel des "temps anciens"
Gravure de la récolte du
sel des "temps anciens"
|
Historique des salines et marais salants
à Eres, Ières, Hières, Hyères
-- Dans des temps très anciens
L'homme a observé que l'assèchement de certaines flaques
d'eau déposait des cristaux blancs qui avaient certaines propriétés
gustatives et de conservation.
-- Au début du millénaire
Ce sont probablement les grecs, puis les romains qui du temps de "Olbia
- Pomponiana" ont commencé à aménager les
premières tables à l'Est de l'embouchure du Gapeau pour
y recueillir du sel en grande quantité. Les salines "d'Eres"
étaient nées.
Par la suite, Rome tire des bénéfices substantiels de
son sel sur tout son empire et la voie qui part d'Ostie (avant-port
de Rome) vers le Nord, s'appele la "via salaria".
-- Au Xème siècle
Les salines d'Hières
et ses pêcheries sont la propriété des monastères
de Saint Pierre de Montmajour (à proximité d'Arles) et
de Saint Victor (de Marseille) (2).
Les pêcheries se trouvent
alors dans l'étang du Pesquier.
-- Au XIIIème siècle
Les salines s'étendent sur cinq zones (voir carte
ci-dessous):
- Fabrégat (vers St Nicolas Mauvanne -> Vieux
Salins actuels) -> Chapelle St Benoit.
- Maufanguet -> Chapelle Notre Dame du Plan
- Etang long et large [au Palyvestre-> qui est une
déformation de Paluestre, mot lié au palu(d) qui désigne
un marais] -> Chapelle St Michel
- L'Almanarre -> Chapelle St Michel
- Giens ; au lieu dit "le cul de Giens"(à
l'emplacement du marais des Estagnets) dans un courrier de 1265
(3).
C'est la période la plus florissante des salins. Il existe alors
un traité de vente de sel entre les villes de Gênes et
de Hyères.
Après les moines, ce sont les seigneurs de Provence qui tirent
leurs profits du sel en louant ces petites unités de production
à des fermiers. Les bateaux sont souvent chargés de
sel pour les trajets retour afin de ne pas rentrer à vide. Le
chargement de ceux-ci n'est pas facile car il n'existe pas de port dans
la rade qui permette l'accostage de grosses unités. Face à
l'augmentation de la demande, les salins ne peuvent plus fournir les
"gros clients" qui vont alors s'approvisionner ailleurs (2).
Une enquête sur les droits du roi (et comte de Provence) dans
la ville et la vignerie d'Hières en 1332 nous apprend qu'à
cette époque les salines de Guillaume Roque, de Bernard Hugon,
de Jean Baude et d'Aggline et Cardone Malabrieus, situées dans
l'étang long et large (stagno longo et lato) sont abandonnés
"depuis longtemps".
Cette explication "depuis longtemps" ne doit pas nous en imposer
et nous faire croire qu'il s'agit d'un siècle par exemple. En
effet dans un document de 1290 sur les droits perçus aux salines
d'Hières par le roi-comte, nous voyons que les salines de l'étang
long et large sont en pleine activité et d'une importance presque
égale à celle des vieux salins. En effet si, pour ces
dernières salines nous avons relevé (sauf erreur) 31 propriétaires,
l'étang en comptait 19 et l'étang large 4, soit 23 en
tout.
Evidemment les salines de cette époque n'avaient pas de grandes
étendues puisque l'exploitation en était presque familiale.
En effet un document de 1364 nous apprend qu'elles pouvaient varier
de 1680m2 (28 cannes sur 15 cannes) à 73320 m2, soit, pour 7
salines aux surfaces connues, une moyenne de 1,71 ha..
Et pourquoi, direz-vous ces salines au sud du terroir hiérois
ont-elles disparu ? Il est assez facile de répondre, d'une manière
plausible, à cette question. Ces salines étaient fréquemment
inondées par les débordement du Gapeau et du Roubaud (lce
dernier n'avait d'ailleurs pas d'issue à la mer, mais se jetait
directement dans les marais et étangs).
On peut croire que, vers 1300, des inondations plus fortes que d'habitude
rompirent digues et "chaussées", ravinèrent
les tables salantes et que les propriétaires qui devaient lutter
continuellement durent se décourager et abandonner leurs salines.
De la sorte, les Vieux Salins subsistèrent seuls jusqu'à
la deuxième moitié du XIXème siècle, époque
à laquelle une partie de l'ancien étang long fut à
nouveau transformé en salines : les Salins des Pesquiers. L'histoire
n'est-elle pas un recommencement ? (3)
|

Extrait de plan des Salins Vieux
de 1885
Grandes dimensions : 4000m x 800m - (zoom)
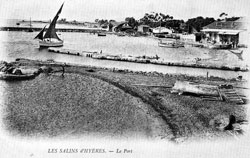
Port des Salins avec le début
de canal qui alimente les salines d'Hières - (zoom)

Martelière de régulation
d'alimentation
du canal des salines d'Hières - (zoom)

Canal d'alimentation des salines
d'Hières
et ses maisons de pêcheurs - (zoom)

Vue globale des salines d'Hières.
Ses formes très irrégulières témoignent
de l'agrandissement progressif des "salins vieux" au fil des
siècles - (zoom)
|
|
-- Au XVIIIème siècle
Avant la Révolution de 1789, l'activité du sel en Provence
nécessite l'installation de sept greniers à sel, dont
un à Hyères. Celui-ci est sous la direction d'un officier
qui surveille l'exploitation,
la production et la vente du sel, dans l'intérêt de l'état.
Notre ville est alors l'un des trois centres les plus importants de
production (l'Aude, la Camargue et Hyères) (2)
-- Au XIXème siècle
* En 1806, la compagnie
Eynard acquiert les 350 hectares des salines d'Hyères afin de
les rénover (Fabrégas-Saint Nicoles -->
les Vieux Salins d'Hyères aujourd'hui).
* En 1822, le cours du Roubaud ne se
jette plus dans l'Etang du Pesquiers. Il est détourné
pour se jeter au port de l'Ayguade.
* En 1848, messieurs Gérard et Chappon (commerçants
à Toulon) achètent l'étang du Pesquier qui
abrite alors une pêcherie.
Ils conservent partiellement cette activité, mais transforment
progressivement l'immense lagune en un salin sur 550 hectares. A cet
effet, ils prélèvent le sable dont ils ont besoin dans
le cordon littoral du tombolo ouest.
Celui-ci verra à ce moment là, sa largeur diminuer d'une
façon
importante et irréversible.
* En 1856, la Compagnie des Salins du Midi achète les salines
d'Hyères à la compagnie
Eynard afin de concurencer
le nouveau salin du Pesquier qui vient d'être aménagé.
C'est à partir de ce moment là que le terme
de "vieux salins" apparaît.
Pour améliorer la productivité de ces derniers, la restructuration
porte essentiellement sur l'unification de la gestion hydraulique.
--
Au XXème siècle
En 1966, la
Compagnie des Salins du Midi devient propriétaire
du site des Pesquiers.
Elle continue progressivement à augmenter la surface des
tables salantes en utilisant la totalité de l'étang pour
concentrer le sel. Cela va d'ailleurs perturber la vie aquatique de
ses habitants car l'eau saumâtre disparaît. (2).
Elle priviligie alors ce dernier site et arrête l'exploitation
salinière des "vieux salins"
à partir de 1970 .... qu'elle reprendra ensuite "symboliquement"
de 1983 à 1995.
La cessation définitive d'activité pour les deux sites
a lieu en 1995 pour des raisons économiques.
La gestion hydraulique minimale est poursuivie jusqu'en 2001.
Au total les deux
sites représentent une superficie totale d'environ 900 hectares
(avec l'espace des Vieux Salins).
Cet ensemble est acheté par le Conservatoire du Littoral en septembre
2001. |

Plan positionnant les aires salines,
les chapelles dont elles dépendaient, les points forts et les
castrum au XIIIème siècle - (zoom)

Les "salins neufs" dit
salins des Pesquiers.
Le canal alimente l'étang des Pesquiers qui fait office de
bassin de décantation et de réserve d'eau de mer (2500m
x 1000m). Les tables salantes occupent un espace de 1600m x1600m.
On peut voir la position des 2 machines qui relèvent l'eau
- (zoom)
|
Fonctionnement des
marais salants (1)
La mer est salée à
cause de la dissolution des sels minéraux transportés par
les cours d'eau se jetant dans l'océan il y a des millions d'années.
Les marais salants vont donc consister à réaliser l'opération
inverse afin d'extraire le sel de l'eau de mer. Celle-ci va cheminer dans
de nombreux bassins pour s'évaporer progressivement. Pour 1000
litres qui entrent dans le salin, seulement 110 litres arriveront sur
les tables salantes où se fera la récolte. Il faudra de
nombreux mois et un cheminement d'une dizaine de kilomètres pour
arriver à récolter le sel. Il est à noter que durant
cette opération la majorité des bassins vont se trouver
en dessous du niveau de la mer.
Le plan ci-après schématise le parcours de l'eau de mer
dans les différents bassins avec deux stations élévatoires
P1 (avec un double tympan) et P2 (avec un simple tympan). La station P3
sert à renvoyer à la mer les eaux de vidange (ou exédentaires)
des bassins. Ce schéma de fonctionnement a varié au fur
et à mesure de l'extension du marais salant.
En principe, le marais n'est en eau qu'à partir du printemps. Pendant
la saison froide, le marais est inactif, les exploitants en profitent
pour faire les travaux d'entretien nécessaires.
|
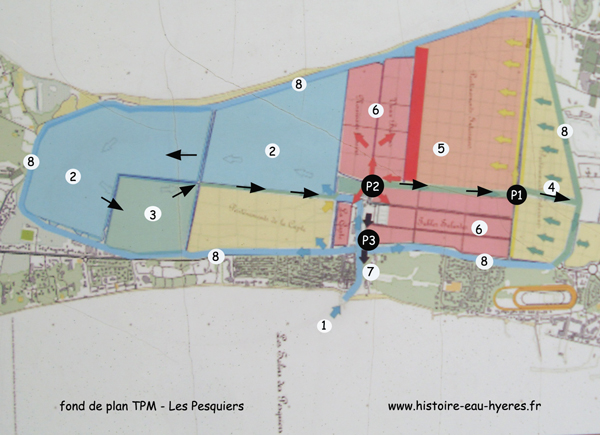 Schéma de fonctionnement
du salin des Pesquiers
Schéma de fonctionnement
du salin des Pesquiers
|
 Le passage du gras sert de
prise d'eau pour les marais salants. Le port et le village de
l'Acate (La Capte) n'existe pas encore en 1900 - (zoom -> vue
détaillé des martelières. En arrière,
le canal est couvert sur une surface importante. Il permet de
mettre à l'abri des intempéries les barges qui sont
chargées de sel dans l'attente d'un transbordement dans
les bateaux qui sont ancrés dans la rade (zoom)
Le passage du gras sert de
prise d'eau pour les marais salants. Le port et le village de
l'Acate (La Capte) n'existe pas encore en 1900 - (zoom -> vue
détaillé des martelières. En arrière,
le canal est couvert sur une surface importante. Il permet de
mettre à l'abri des intempéries les barges qui sont
chargées de sel dans l'attente d'un transbordement dans
les bateaux qui sont ancrés dans la rade (zoom)
.
|
 "Le tympan" est
le système élévatoire qui permettait de relever
l'eau de l'extérieur vers le centre de la roue d'où
elle repartait vers d'autres tables. Celui du salin d'Hyères
est le seul exemplaire existant en France. (zoom)
"Le tympan" est
le système élévatoire qui permettait de relever
l'eau de l'extérieur vers le centre de la roue d'où
elle repartait vers d'autres tables. Celui du salin d'Hyères
est le seul exemplaire existant en France. (zoom)
|
|
|
-- Le gras - 1
On utilise l'effet de la marée haute (en Méditerranée
40cm maximum) afin de faire pénétrer dans
un chenal nommé "le gras" une certaine quantité
d'eau de mer (concentré à 29 g de NaCl par litre) afin
d'atteindre le niveau souhaité. La manoeuvre se fait au moyen
de martelières (ou vannes).
--
L'étang (ou vasière ou chauffoir)
- 2 et 3
Cette eau de mer va arriver dans
un vaste bassin appelé "l'étang" ou "vassière"
ou "chauffoir" suivant les régions, dans laquelle elle
va se chauffer et commencer à se concentrer. Dans une hauteur
d'eau variable, car la surface n'a pas été nivellée.
Cette eau va décanter toutes ses impuretés. L'étang
contient un volume d'eau suffisant pour alimenter tous les bassins du
marais.
--
Partement (ou cobier ou promenoir)
- 4
Dans le partement extérieur ou la décantation se poursuit,
l'eau continue à monter en température et à s'évaporer
dans une profondeur de 4cm environ.
--
Partements
extérieur
et
intérieurs (ou
fares)
4 et 5
Le circuit de l'eau se faisant par gravité, il est installé
au salin des Pesquiers trois "tympans" dont le role est de
relever l'eau afin qu'elle puisse disposer d'une certaine pente pour
continuer son long circuit dans les partements intérieurs qui
permettent une forte évaporation dans 4 à 5cm d'eau. Ces
machines sont actionnées à la fin XIXème siècle
à l'aide de locomobiles à vapeur, puis ensuite par des
moteurs électriques. Des canaux et des martelières permettent
à un même tympan de relever l'eau pour des circuits différents.
--
Tables salantes (ou oeillets)
- 6
Les tables sont les derniers bassins du circuit . Le fond est parfaitement
aplani et compacté (en fin récolte avant sa remise en
eau). L'épaisseur de l'eau est de 0,5 à 1cm. Celle-ci,
saturée à 260 g de NaCl permet la cristallisation
finale. Le récolte du sel peut avoir lieu.
En suivant son cheminement l'eau aura parcouru entre 10 et 15
km.
--
Canal de vidange - 7
Un canal de vidange permet de collecter toutes
les eaux excédentaires. Il
est important que la dernière des tables puisse être vidé
totalement
en fin de saison pour son nettoyage et sa préparation pour la
récolte suivante.
Des pompes (initialament le tympan n°2) assurent cette fonction
afin d'évacuer cette eau . Actuellement se sont deux vis sans
fin de 1000 m3/h (pompe n° 3) qui relèvent l'eau de 3,88
m pour la rejeter dans le canal de ceinture, en direction de la mer.
Ce système permet de préserver la vie des trés
nombreux poissons, petits et gros) qui se trouvent dans ce circuit d'eau.
--
La canal de ceinture (ou
étier) - 8
Un canal a été creusé
autour des salins afin de les préserver du vol de "sel".
Si aujourd'hui, cela nous semble étrange, durant des centaines
d'années le sel avait une valeur très importante.
Le canal sert également à drainer les eaux pluviales des
terrains environnant qui malheureusement le polluent de différentes
manières et provoquent en période estivale des odeurs
désagréables. |

Panorama sur les tables salantes
avec au premier plan le canal de ceinture qui draine toutes les eaux
pluviales et de vidange des tables salantes. A droite, le futur CD
97 - (zoom)
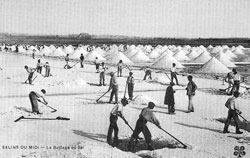
Ramassage et battage du sel -
(zoom)

Mise en gerbe du sel sous l'oeil
avisé du contremaître - (zoom)
|
 Initialement le transport
du sel pour former les camelles
Initialement le transport
du sel pour former les camelles
se fait à l'aide de couffins - (zoom) |
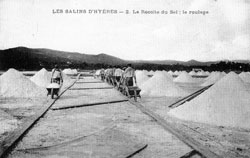 Le "roulage"
à la brouette sur les autoroutes de planches
Le "roulage"
à la brouette sur les autoroutes de planches
pour la récupération des gerbes - (zoom)
|
 Un travail d'endurance
et d'équilibre - (zoom)
Un travail d'endurance
et d'équilibre - (zoom) |
|
|
La
récolte
a)
Différents types de sel
a1)
La fleur de sel
La "fleur de sel" est constituée de cristaux fins et
légers flottant à la surface qui doit être ramassé
avec délicatesse. C'est "le caviar du sel".
A Hyères, la fleur de sel ne fût jamais récolté
mais plutôt retiré de la surface de l'eau car elle ralentissait
l'évaporation de l'eau (2)
Celle-ci se fait durant les trois mois d'été
; juin, juillet et août.
a2)
Le
gros sel
C'est le sel courant que l'on va ramasser sur les tables salantes qui
servira soit à la consommation humaine ou industrielle.
b)
Différents types de ramassage
b1)
Avant la mécanisation
-- Jusqu'au début du XXème siècle le battage du
sel se fait à l'aide de pelles et pioches pour constituer des
"gerbes" (tas côniques) ou "mulons"
et le transport à l'aide de couffins.
-- Ensuite vient "le roulage" sur des planches avec les brouettes
qui rassemble le sel afin de constituer des camelles (grands
tas de sel) en montant en équilibre sur des échafaudages.
Lors de cette opération, un premier nettoyage du sel est effecté
afin d'enlever les plus grosses impuretés transportées
par le vent durant la période de séchage. (plumes d'oiseaux,
brindilles etc..)
b2)
Avec la mécanisation
-- Le sel va être rassemblé "en ligne" toujours
à l'aide de pelles et pioches et des wagonnets sur rails vont
permettre de ramener le sel vers le lieu de stockage central.
-- Un ensemble motorisé, d'abord tracté, puis poussé,
nommé "la favouille" permettra de ramasser le sel et
de le vider directement dans une remorque à l'aide d'un tapis
roulant. Il est à noter qu'à ce type de ramassage le fond
est détérioré par le roulage des véhicules.
c)
Différents stockages
c1)
Avant la mécanisation
Le
sel est stocké en bordure et tout le long des tables salantes
que l'on va ensuite recouvrir de tuiles pour protéger le sel
des intempéries (pluies à action dissolvante, poussières,
sable etc..). Le conditionnement se fera sur place.
c2)
Avec la mécanisation
--
Après le détoiturage des camelles, les wagonnets tirés
par les chevaux vont commencer à diminuer la pénibilité
des travaux en ramenant le sel à un point de conditionnement
central.
-- Les wagonnets tirés par un tracteur sur rail amènent
directement le sel au pied de l'échelle de levage qui va créer
l'immense camelle en arc de cercle qui marquera notre paysage.
d)
La main d'oeuvre
-- La main d'oeuvre saisonnière italienne est initialement constituée
de 300 personnes environ. Ces ouvriers qui vivent dans des cabanes de
fortune ne font pas bon ménage avec les ouvriers locaux.
-- Vers 1990, la mécanisation diminuera à 30 personnes
le personnel nécessaire à la récolte pour une même
production.
Sur le site des Pesquiers, la production moyenne se situe à environ
20000 tonnes de sel par an. S'il y a des orages en juillet-août
la production peut fortement diminuer.
A l'âge d'or des Vieux Salins, la production était
également de l'ordre de 20000 tonnes par an (2).
La
douane et les gabelles
La douane prélève un impôt pour le sel exporté
qui est bien inférieur à celui perçu sur le sel
vendu pour la consommation locale.
Le sel réservé à la consommation humaine est vendu
beaucoup plus cher que celui pour les besoins industriels. Afin d'éviter
la fraude, il est ajouté différents produits au sel industriel
afin de le rendre impropre à la consommation humaine.
Un douanier est en permanence sur le site afin d'éviter toute
fraude. |
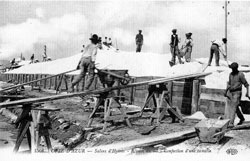
Stockage du sel en camelles -
(zoom)
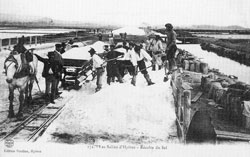
Une partie du transport peut aussi
se faire par
wagonnets sur rail avec traction hippomobile - (zoom)
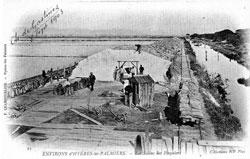
Après le démontage
de la couverture des camelles,
préparation de la commercialisation du sel - (zoom)
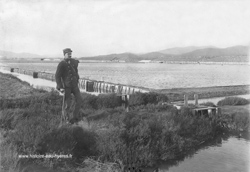
Douanier en surveillance dans
les salins de St Nicolas
(zoom)
|
La
commercialisation
Les camelles sont détoiturées une à une afin de
réaliser le pesage et la mise en sac du sel (au pied même
de la camelle) pour sa commercialisation. Les sacs sont chargés
sur des wagonnets, qui sont amenés jusqu'au ponton d'embarquement
situé à proximité de la prise d'eau du canal (port
actuel de La Capte).
Le sel brût en vrac est chargé sur des barges qui sont
remorquées jusqu'aux navires pour être transbordé
dans les soutes. Le faible tirant d'eau ne permettait pas aux gros bateaux
de venir jusqu'au ponton. Dans le secteur de l'Ayguade plusieurs
tentatives de construction d'un "vrai port" n'aboutiront
jamais.
Les trois quarts de la production est alors exporté.
Une partie sert cependant à la fabrication de soude artificielle
réalisée sur les îles d'Hyères
(Porquerolles et Port-Cros).
Progressivement le train (chargement à l'Almanarre) puis
les camions remplaceront les bateaux pour le transport du sel (2). |

Photo prise en haut du Mont Blanc
???
Non ! Simplement sur une camelle en cours de
débitage aux salins des Pesquiers - (zoom)
|
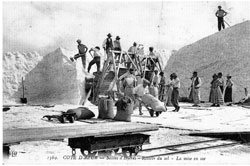 Débitage du sel
brût et mise en sac - (zoom)
Débitage du sel
brût et mise en sac - (zoom) |
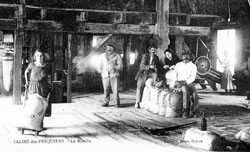 Broyage du sel au moulinet
et finalisation des sacs - (zoom)
Broyage du sel au moulinet
et finalisation des sacs - (zoom) |

Le sel est chargé sur les wagonnets - (zoom) |
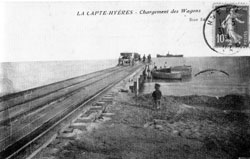
Ponton d'embarquement
du sel sur les bateaux à La Capte - (zoom)
|

La barque est chargée à partir du ponton
- (zoom)
|

Le treuil du bateau remplit les cales à partir
du
chargement de la barque - (zoom)
|
|
Cartes
postales issues essentiellement de la collection de Jean-Luc
Delcroix
dont certaines ont été diffusées le samedi
11 mars 2006 dans l'émission de
FR3 Méditerranée - Le Magazine du Littoral Méditérannéen
- "La Belle Bleue"
proposé par Louis AUBERT et Jean-Louis BOUDART réalisé
par Eric PIO.
Ci-dessous une image "souvenir" du générique
de fin d'émission sur lequel nous avons eu le plaisir
de figurer.
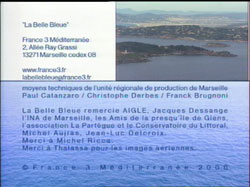
Générique
de fin d'émission - (zoom)
(1) Informations
recueilles sur le site :
http://www.ac-rennes.fr/
(2) Informations verbales de M. SIMO Marc
(TPM)
(3) Extrait de presse de Gustave ROUX (Médiathèque
d'Hyères)
|
|
Quelques
images de la "mécanisation" progressive
de l'exploitation des salins
|
|
|
|
LA
GESTION DES SALINS D'HYERES AUJOURD'HUI
|
|
|
|
|
Compléments d'informations sur les sites :
- du conservatoire
du littoral
|
|